 |
Grigori Kozintsev
|
 |
 |
Grigori Kozintsev
|
 |
Grigori Kozintsev, jeune Ukrainien, devient dès l’âge de 14 ans, apprenti décorateur et participe à des spectacles d’agit-prop : il y fait la connaissance de Sergueï Youtkevitch. En 1920, il part pour Leningrad : inscrit à l’Académie des Beaux-Arts, il y suit des cours de peinture et se lie d’amitié avec Leonid Trauberg.
Ils sont influencés par les théories théâtrales de Meyerhold et l’activisme poétique de Maïakovski, marqués par les premiers films burlesques de Chaplin.
En 1921, ils créent avec Youtkevitch la FEKS (Fabrique de l’acteur excentrique). Guerassimov y participe en tant qu’acteur et Eisenstein (très provisoirement) en tant que professeur.
Ils font la mise en scène théâtrale, associant cirque, cabaret et cinéma, de l’Hyménée de Gogol. Puis Kozintsev et Leonid Trauberg débutent au cinéma : leur collaboration ne prendra fin qu’en 1945. Kozintsev assume la vision créatrice du film. Trauberg se consacre essentiellement au scénario, aux dialogues, à la définition des personnages et au découpage.
Ils réalisent en 1924 Les aventures d’Octobrine, comédie d’agit-prop où ils dénoncent la cupidité des capitalistes occidentaux qui exigent des paysans et ouvriers le remboursement des dettes tsaristes. Les comédies « excentriques » laissent progressivement place à des œuvres plus graves où s’expriment des préoccupations liées aux bouleversements de l’histoire. En 1929, ils réalisent La nouvelle Babylone, qui évoque les événements tragiques de la Commune de Paris. Seule (1931) montre les difficultés de la collectivisation des campagnes. A partir de cette date, les réalisateurs renoncent à l’art « excentrique » au profit du réalisme et de la réalité soviétique contemporaine. Leur choix de héros « positifs » se manifeste dans la trilogie des Maxime (1935-1939) : le personnage principal y incarne le prolétaire révolutionnaire, combattant exemplaire avant, pendant, et après la révolution d’Octobre.
Pendant la guerre, Kozintsev réalise en collaboration avec Lev Arnchtam deux « ciné-recueils de guerre » Rencontre avec Maxime (1941) et Incident au bureau du télégraphe (1941). Mais le film Des gens simples (1945), réalisé avec Leonid Trauberg, qui évoque la dureté des conditions de vie du front intérieur sera interdit jusqu’en 1956. Kozintsev et Trauberg se séparent alors définitivement.
Seul, Kozintsev réalise des biographies filmées, puis revient au théâtre. Sa carrière de cinéaste repart au moment du "dégel"». Don Quichotte (1957), mais surtout Hamlet (1964) et Le roi Lear (1971) lui vaudront l’admiration internationale. Soucieux de la vérité historique des décors et de l’atmosphère d’époque, il souligne dans ces œuvres grandioses l’universalité de ses idéaux humanistes. Kozintsev a écrit plusieurs ouvrages de réflexion sur son art.
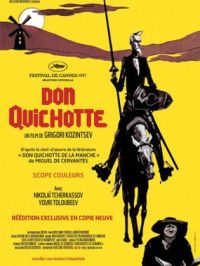 |
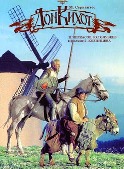 |
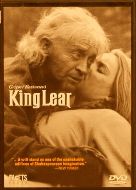 |
 |
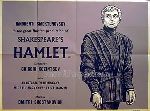 |